Lettre de Toussaint Louverture à Napoléon Bonaparte
Citoyen Consul,
Votre lettre
m’a été transmise par le citoyen Leclerc, votre beau-frère, que vous avez nommé
capitaine-général de cette île : titre qui n’est point reconnu par la
constitution de Saint-Domingue. Le même messager a rendu deux enfants innocents
aux embrassements et à la tendresse de leur père. Mais quelques chers que me
soient mes fils, je ne veux point avoir d’obligation à mes ennemis, et je les
renvoie à leurs geôliers.
Les forces destinées à faire
respecter la souveraineté du peuple français ont aussi effectué une descente ;
elles répandent partout le carnage et la dévastation. De quel droit veut-on
exterminer, par le fer et par le feu, un peuple grossier, mais innocent ? Nous
avons osé former une constitution adaptée aux circonstances. Elle contient de
bonnes choses, comme vous en convenez vous-même ; mais il s’y trouve aussi,
dites-vous, des articles contraires à la souveraineté du peuple français. En
quoi consiste donc cette souveraineté ? Quelle est son étendue ? Doit-elle être
sans mesures et sans limites ?
Saint-Domingue, cette Colonie,
qui fait partie intégrante de la République française, aspire, dit-on, à
l’indépendance. Pourquoi non ? Les États-Unis d’Amérique ont fait comme nous ;
et avec l’assistance du gouvernement français, ils ont réussi à consolider leur
liberté. Mais, répondez-vous, il y a des défauts dans votre constitution. Je le
sais. Quelle institution humaine en est exempte ? Néanmoins, je suis persuadé
que le système que vous avez adopté pour votre République, ne peut garantir,
d’une manière plus certaine, la liberté individuelle ou politique, la liberté
de la presse ni les droits de l’homme. Le poste élevé que j’occupe n’est pas de
mon choix ; des circonstances impérieuses m’y ont placé contre mon gré. Je n’ai
pas détruit la constitution que j’avais juré de maintenir. Je vis cette
malheureuse île en proie à la fureur des factieux. Ma réputation, ma couleur,
me donnèrent quelque influence sur le peuple qui l’habite ; et je fus, presque
d’une voix unanime, appelé à l’autorité. J’ai étouffé la sédition, apaisé la
révolte, rétabli la tranquillité ; j’ai fait succéder le bon ordre à l’anarchie
; enfin, j’ai donné au peuple la paix et une constitution. Citoyen Consul, vos
prétentions sont-elles fondées sur des titres plus légitimes ? Si le peuple ne
jouit pas ici de toute la liberté qu’on trouve sous d’autres gouvernements, il
en faut chercher la cause dans sa manière de vivre, dans son ignorance et dans
la barbarie inséparable de l’esclavage. Le gouvernement que j’ai établi pouvait
seul convenir à des malheureux à peine affranchis du joug oppresseur ; il
laisse, en plusieurs endroits, prise au despotisme, nous n’en saurions
disconvenir ; mais la constitution de la France, cette partie-là plus éclairée
de l’Europe, est-elle tout à fait exempte de ces inconvénients ? Si trente
millions de Français trouvent, comme je l’entends dire, leur bonheur et leur
sécurité dans la Révolution du 18 brumaire, on ne devrait pas m’envier l’amour
et la confiance des pauvres noirs, mes compatriotes. La postérité décidera si
nous avons été obéis par affection, par apathie ou par crainte.
Vous offrez la liberté aux noirs
en disant que, partout où vous avez été, vous l’avez donnée à ceux qui ne
l’avaient pas. Je n’ai qu’une connaissance imparfaite des événements qui ont eu
lieu récemment en Europe, mais les rapports qui me sont parvenus ne s’accordent
pas avec cette assertion. La liberté dont on peut jouir en France, en Belgique,
en Suisse, ou dans les républiques Batave, Ligurienne et Cisalpine, ne
satisferait jamais le peuple de Saint-Domingue. Nous sommes loin d’ambitionner
une pareille indépendance.
Vous me demandez si je désire de
la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute ; mais je ne
veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes
compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de leur fidélité. Me
parle-t-on de mon agrandissement personnel dans l’espoir de m’engager à trahir
la cause que j’ai embrassée ? Vous devriez apprendre à juger des autres par
vous-même. Si le monarque qui sait avoir des droits au trône sur lequel vous
êtes assis, vous commandait d’en descendre, que répondriez-vous ? La puissance
que je possède est aussi légitimement acquise que la vôtre ; et la voix unanime
du peuple de Saint-Domingue peut seule me forcer à l’abandonner. Elle n’est
point cimentée par le sang. Les hommes cruels, dont j’ai arrêté les
persécutions ont reconnu ma clémence. Si j’ai éloigné de cette île certains
esprits turbulents qui cherchaient à entretenir le feu de la guerre civile,
leur crime a d’abord été constaté devant un tribunal compétent, et enfin avoué
par eux-mêmes. Est-il quelqu’un d’entre eux qui puisse dire avoir été condamné
sans être entendu ? Cependant, ces mêmes hommes vont revenir encore une fois ;
ils vont déchaîner de nouveau les assassins de Cuba pour nous dévorer, et ils
osent prendre le nom de chrétiens. Pourquoi vous étonnez-vous de ce que j’ai
protégé la religion et le culte du Dieu créateur de toutes choses ! Hélas !
j’ai toujours honoré et glorifié cet être plein de douceur, dont la parole
sacrée n’a que depuis peu trouvé grâce auprès de vous. C’est dans son appui que
j’ai cherché ma consolation au milieu des périls ; et jamais je n’ai été trompé
dans mes espérances. Je suis, dites-vous, responsable devant lui et devant vous
des massacres qui se commettent dans cette île infortunée ; j’y consens. Que
notre sort dépende de sa justice ! qu’il décide entre moi et mes ennemis, entre
ceux qui ont violé ses préceptes et abjuré son saint nom, et l’homme qui n’a
jamais cessé de l’adorer.
Signé : Toussaint Louverture, mi-février 1802
Source : Portail de Frantz Fanon
Tags:
Bonaparte
Expédition Leclerc
France
Haiti
Lettre
Napoléon
Napoléon Bonaparte
Toussaint
Toussaint Louverture


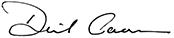






























0 Commentaires