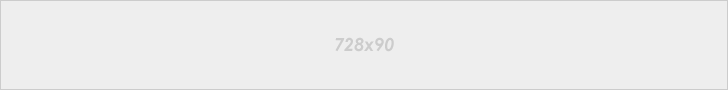Discours « Beyond Vietnam: A Time to Break Silence » de Martin Luther King Jr., prononcé le 4 avril 1967 à l'église Riverside de New York.
Au-delà du Vietnam : l’heure de briser le silence
Monsieur le Président, mesdames et messieurs :
Je n’ai pas besoin de m’attarder pour dire à quel point je suis ravi d’être ici ce soir, et combien je suis heureux de vous voir exprimer votre préoccupation pour les questions qui seront discutées ce soir en venant en si grand nombre. Je tiens aussi à dire que je considère comme un grand honneur de partager cette tribune avec le Dr Bennett, le Dr Commager et le rabbin Heschel, ainsi qu’avec certains des dirigeants et personnalités distingués de notre nation. Et bien sûr, il est toujours bon de revenir à l’église Riverside. Au cours des huit dernières années, j’ai eu le privilège de prêcher ici presque chaque année, et c’est toujours une expérience riche et gratifiante de venir dans cette grande église et à cette grande chaire.
Je viens ce soir dans cette magnifique maison de culte parce que ma conscience ne me laisse pas d’autre choix. Je me joins à vous dans cette réunion parce que je suis profondément d’accord avec les objectifs et le travail de l’organisation qui nous a réunis : le Clergy and Laymen Concerned About Vietnam. Les récentes déclarations de votre comité exécutif sont les sentiments de mon propre cœur, et je me suis retrouvé pleinement en accord lorsque j’ai lu ses premières lignes : « Un moment arrive où le silence devient trahison. » Et ce moment est arrivé pour nous en ce qui concerne le Vietnam.
La vérité de ces mots ne fait aucun doute, mais la mission à laquelle ils nous appellent est des plus difficiles. Même pressés par les exigences de la vérité intérieure, les hommes n’assument pas facilement la tâche de s’opposer à la politique de leur gouvernement, surtout en temps de guerre. L’esprit humain ne se meut pas non plus sans grande difficulté contre toute l’apathie de la pensée conformiste qui est en soi et dans le monde environnant. De plus, lorsque les enjeux semblent aussi perplexes qu’ils le sont souvent dans ce terrible conflit, nous sommes toujours au bord d’être hypnotisés par l’incertitude ; mais nous devons avancer.
Et certains d’entre nous qui ont déjà commencé à briser le silence de la nuit ont découvert que l’appel à parler est souvent une vocation d’agonie, mais nous devons parler. Nous devons parler avec toute l’humilité qui convient à notre vision limitée, mais nous devons parler. Et nous devons aussi nous réjouir, car c’est sans doute la première fois dans l’histoire de notre nation qu’un nombre significatif de ses dirigeants religieux ont choisi de s’élever au-delà de la prophétie d’un patriotisme lisse vers les hauteurs d’une ferme dissidence fondée sur les mandats de la conscience et la lecture de l’histoire. Peut-être qu’un nouvel esprit se lève parmi nous. S’il en est ainsi, traçons ses mouvements et prions pour que notre propre être intérieur soit sensible à sa guidance, car nous avons profondément besoin d’une nouvelle voie au-delà des ténèbres qui semblent si proches autour de nous.
Au cours des deux dernières années, alors que j’ai commencé à briser la trahison de mes propres silences et à parler depuis les brûlures de mon propre cœur, alors que j’ai appelé à des départs radicaux de la destruction du Vietnam, beaucoup de personnes m’ont interrogé sur la sagesse de ma voie. Au cœur de leurs préoccupations, cette question a souvent surgi, forte et bruyante : « Pourquoi parlez-vous de la guerre, Dr King ? » « Pourquoi rejoignez-vous les voix de la dissidence ? » « La paix et les droits civiques ne se mélangent pas », disent-ils. « N’êtes-vous pas en train de nuire à la cause de votre peuple ? », demandent-ils ?
Et quand je les entends, bien que je comprenne souvent la source de leur préoccupation, je suis néanmoins profondément attristé, car de telles questions signifient que les interrogateurs ne m’ont vraiment pas connu, ni mon engagement ni ma vocation. En effet, leurs questions suggèrent qu’ils ne connaissent pas le monde dans lequel ils vivent.
À la lumière d’un tel malentendu tragique, je juge d’une importance capitale d’essayer d’expliquer clairement, et j’espère de façon concise, pourquoi je crois que le chemin depuis l’église baptiste de Dexter Avenue – l’église de Montgomery, en Alabama, où j’ai commencé mon pastorat – mène clairement jusqu’à ce sanctuaire ce soir.
Je viens à cette tribune ce soir pour adresser une supplique passionnée à ma nation bien-aimée. Ce discours n’est pas adressé à Hanoï ni au Front national de libération. Il n’est pas adressé à la Chine ni à la Russie. Ce n’est pas non plus une tentative d’ignorer l’ambiguïté de la situation globale ni le besoin d’une solution collective à la tragédie du Vietnam. Ce n’est pas non plus une tentative de faire des Nord-Vietnamiens ou du Front national de libération des parangons de vertu, ni d’ignorer le rôle qu’ils doivent jouer dans la résolution réussie du problème.
Bien qu’ils puissent avoir des raisons justifiables de se méfier de la bonne foi des États-Unis, la vie et l’histoire témoignent éloquemment du fait que les conflits ne sont jamais résolus sans un échange confiant des deux côtés. Ce soir, cependant, je souhaite m’adresser non pas à Hanoï et au Front national de libération, mais plutôt à mes compatriotes américains.
Puisque je suis prédicateur de vocation, je suppose qu’il n’est pas surprenant que j’aie sept raisons majeures de placer le Vietnam dans le champ de ma vision morale.
Il y a d’abord un lien très évident et presque facile entre la guerre au Vietnam et la lutte que moi et d’autres menons en Amérique. Il y a quelques années, il y eut un moment lumineux dans cette lutte. Il semblait y avoir une réelle promesse d’espoir pour les pauvres – noirs et blancs – à travers le programme de lutte contre la pauvreté. Il y avait des expériences, des espoirs, de nouveaux débuts. Puis vint l’escalade au Vietnam, et j’ai vu ce programme brisé et éviscéré comme s’il n’était qu’un jouet politique futile d’une société devenue folle de guerre, et je savais que l’Amérique n’investirait jamais les fonds ni les énergies nécessaires à la réhabilitation de ses pauvres tant que des aventures comme le Vietnam continueraient à aspirer hommes, compétences et argent comme un tube d’aspiration destructeur et démoniaque.
Je fus donc de plus en plus contraint de voir la guerre comme un ennemi des pauvres et de l’attaquer en tant que telle.
Peut-être une reconnaissance plus tragique de la réalité eut lieu quand il devint clair pour moi que la guerre faisait bien plus que dévaster les espoirs des pauvres chez nous. Elle envoyait leurs fils, leurs frères et leurs maris se battre et mourir dans des proportions extraordinairement élevées par rapport au reste de la population. Nous prenions les jeunes Noirs américains qui avaient été estropiés par notre société et les envoyions à huit mille miles de là pour garantir des libertés en Asie du Sud-Est qu’ils n’avaient pas trouvées dans le sud-ouest de la Géorgie ni à East Harlem.
Et ainsi nous avons été confrontés à maintes reprises à l’ironie cruelle de voir des garçons noirs et blancs sur les écrans de télévision se tuer et mourir ensemble pour une nation qui n’a pas été capable de les faire asseoir ensemble dans les mêmes écoles. Et nous les regardons dans une solidarité brutale brûler les huttes d’un pauvre village, mais nous réalisons qu’ils vivraient à peine dans le même quartier à Chicago.
Je ne pouvais pas rester silencieux face à une telle manipulation cruelle des pauvres.
Ma troisième raison va à un niveau encore plus profond de conscience, car elle naît de mon expérience dans les ghettos du Nord au cours des trois dernières années – surtout les trois derniers étés. Alors que je marchais parmi les jeunes hommes désespérés, rejetés et en colère, je leur ai dit que les cocktails Molotov et les fusils ne résoudraient pas leurs problèmes. J’ai essayé de leur offrir ma plus profonde compassion tout en maintenant ma conviction que le changement social vient le plus significativement par l’action non violente. Mais ils demandent – et à juste titre – : « Et le Vietnam ? » Ils demandent si notre propre nation n’utilisait pas des doses massives de violence pour résoudre ses problèmes, pour apporter les changements qu’elle voulait. Leurs questions touchent au cœur, et je savais que je ne pourrais plus jamais élever la voix contre la violence des opprimés dans les ghettos sans avoir d’abord parlé clairement au plus grand pourvoyeur de violence au monde aujourd’hui : mon propre gouvernement.
Pour le bien de ces garçons, pour le bien de ce gouvernement, pour le bien des centaines de milliers qui tremblent sous notre violence, je ne peux pas rester silencieux.
Pour ceux qui posent la question : « N’êtes-vous pas un dirigeant des droits civiques ? » et entendent par là m’exclure du mouvement pour la paix, je réponds ceci. En 1957, quand un groupe d’entre nous a formé la Southern Christian Leadership Conference, nous avons choisi comme devise : « Sauver l’âme de l’Amérique. » Nous étions convaincus que nous ne pouvions limiter notre vision à certains droits pour les Noirs, mais nous affirmions plutôt la conviction que l’Amérique ne serait jamais libre ni sauvée d’elle-même tant que les descendants de ses esclaves ne seraient pas complètement libérés des chaînes qu’ils portent encore.
D’une certaine manière, nous étions d’accord avec Langston Hughes, ce barde noir de Harlem, qui avait écrit plus tôt :
> Ô oui, je le dis clairement,
> L’Amérique n’a jamais été l’Amérique pour moi,
> Et pourtant je prête ce serment –
> L’Amérique le sera !
Maintenant, il devrait être d’une clarté incandescente que quiconque se soucie de l’intégrité et de la vie de l’Amérique aujourd’hui ne peut ignorer la guerre actuelle. Si l’âme de l’Amérique devient totalement empoisonnée, une partie de l’autopsie devra porter : Vietnam.
Elle ne pourra jamais être sauvée tant qu’elle détruit les espoirs les plus profonds des hommes du monde entier. C’est pourquoi ceux d’entre nous qui sont encore déterminés à ce que l’Amérique soit – sont conduits sur le chemin de la protestation et de la dissidence, travaillant pour la santé de notre terre.
Comme si le poids d’un tel engagement envers la vie et la santé de l’Amérique n’était pas suffisant, un autre fardeau de responsabilité m’a été imposé en 1954 ; et je ne peux oublier que le Prix Nobel de la paix était aussi une commission, une commission de travailler plus dur que je ne l’avais jamais fait auparavant pour « la fraternité des hommes ». C’est un appel qui me fait dépasser les allégeances nationales, mais même s’il n’était pas présent, je devrais encore vivre avec le sens de mon engagement envers le ministère de Jésus-Christ. Pour moi, la relation de ce ministère à la construction de la paix est si évidente que je m’émerveille parfois de ceux qui me demandent pourquoi je parle contre la guerre.
Se pourrait-il qu’ils ne sachent pas que la Bonne Nouvelle était destinée à tous les hommes – pour les communistes et les capitalistes, pour leurs enfants et les nôtres, pour les Noirs et les Blancs, pour les révolutionnaires et les conservateurs ? Ont-ils oublié que mon ministère est obéissance à Celui qui a aimé ses ennemis si pleinement qu’il est mort pour eux ? Que puis-je alors dire aux Vietcong ou à Castro ou à Mao en tant que ministre fidèle de Celui-ci ? Puis-je les menacer de mort ou ne dois-je pas plutôt partager ma vie avec eux ?
Et enfin, alors que j’essaie d’expliquer pour vous et pour moi-même le chemin qui mène de Montgomery à cet endroit, j’aurais offert tout ce qui est le plus valable si j’avais simplement dit que je dois être fidèle à ma conviction que je partage avec tous les hommes l’appel à être fils du Dieu vivant. Au-delà de l’appel de la race ou de la nation ou de la croyance, il y a cette vocation de filiation et de fraternité, et parce que je crois que le Père est profondément concerné surtout pour ses enfants souffrants, impuissants et exclus, je viens ce soir parler pour eux.
C’est, je crois, le privilège et le fardeau de tous ceux d’entre nous qui se considèrent liés par des allégeances et des loyautés plus larges et plus profondes que le nationalisme et qui vont au-delà des objectifs et positions auto-défini(e)s de notre nation. Nous sommes appelés à parler pour les faibles, pour les sans-voix, pour les victimes de notre nation et pour ceux qu’elle appelle « ennemis », car aucun document issu de mains humaines ne peut rendre ces humains moins nos frères.
Et tandis que je réfléchis à la folie du Vietnam et que je cherche en moi-même des moyens de comprendre et de répondre avec compassion, mon esprit va constamment vers le peuple de cette péninsule. Je parle maintenant non des soldats de chaque camp, non des idéologies du Front de libération, non de la junte à Saigon, mais simplement du peuple qui vit sous la malédiction de la guerre depuis presque trois décennies continues maintenant.
Je pense aussi à eux parce qu’il est clair pour moi qu’il n’y aura pas de solution significative là-bas tant qu’une tentative ne sera pas faite pour les connaître et entendre leurs cris brisés. Ils doivent voir les Américains comme d’étranges libérateurs.
Le peuple vietnamien a proclamé sa propre indépendance en 1945 – après une occupation combinée française et japonaise et avant la révolution communiste en Chine. Ils étaient dirigés par Hô Chi Minh. Même s’ils citaient la Déclaration d’indépendance américaine dans leur propre document de liberté, nous avons refusé de les reconnaître. Au lieu de cela, nous avons décidé de soutenir la France dans sa reconquête de son ancienne colonie. Notre gouvernement a alors estimé que le peuple vietnamien n’était pas prêt pour l’indépendance, et nous sommes de nouveau tombés victimes de l’arrogance mortelle de l’Occident qui a empoisonné l’atmosphère internationale depuis si longtemps.
Avec cette décision tragique, nous avons rejeté un gouvernement révolutionnaire en quête d’autodétermination et un gouvernement établi non par la Chine – pour laquelle les Vietnamiens n’ont pas grande affection – mais par des forces clairement indigènes incluant certains communistes. Pour les paysans, ce nouveau gouvernement signifiait une véritable réforme agraire, l’un des besoins les plus importants de leur vie.
Pendant neuf ans après 1945, nous avons refusé au peuple vietnamien le droit à l’indépendance. Pendant neuf ans, nous avons vigoureusement soutenu les Français dans leur effort avorté de recoloniser le Vietnam. Avant la fin de la guerre, nous financions quatre-vingts pour cent des coûts de guerre français. Même avant que les Français ne soient vaincus à Diên Biên Phu, ils avaient commencé à désespérer de leur action téméraire, mais nous non. Nous les avons encouragés avec nos énormes fournitures financières et militaires à continuer la guerre même après qu’ils eurent perdu la volonté. Bientôt, nous allions payer presque la totalité des coûts de cette tentative tragique de recolonisation.
Après la défaite française, il semblait que l’indépendance et la réforme agraire arriveraient à nouveau par les Accords de Genève. Mais à la place vint les États-Unis, déterminés à ce que Hô ne puisse pas unifier la nation temporairement divisée, et les paysans regardèrent à nouveau tandis que nous soutenions l’un des dictateurs les plus vicieux de l’époque moderne, notre homme choisi, le Premier ministre Diệm.
Les paysans regardèrent et se recroquevillèrent tandis que Diệm extirpait impitoyablement toute opposition, soutenait leurs propriétaires terriens extorqueurs, et refusait même de discuter de la réunification avec le Nord. Les paysans regardèrent tandis que tout cela était présidé par l’influence des États-Unis puis par un nombre croissant de troupes américaines venues aider à réprimer l’insurrection que les méthodes de Diệm avaient provoquée.
Quand Diệm fut renversé, ils purent être heureux, mais la longue lignée de dictateurs militaires ne sembla offrir aucun vrai changement, surtout en termes de leur besoin de terre et de paix. Le seul changement vint d’Amérique, alors que nous augmentions nos engagements de troupes pour soutenir des gouvernements singulièrement corrompus, incompétents et sans soutien populaire.
Tout ce temps, les gens lisaient nos tracts et recevaient les promesses régulières de paix, de démocratie et de réforme agraire. Maintenant ils languissent sous nos bombes et nous considèrent, non leurs compatriotes vietnamiens, comme le véritable ennemi. Ils se déplacent tristement et apathiquement tandis que nous les chassons de la terre de leurs pères vers des camps de concentration où leurs besoins sociaux minimaux sont rarement satisfaits. Ils savent qu’ils doivent partir ou être détruits par nos bombes. Alors ils partent, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils regardent tandis que nous empoisonnons leur eau, tandis que nous détruisons un million d’acres de leurs cultures. Ils doivent pleurer tandis que les bulldozers rugissent à travers leurs zones pour préparer la destruction des précieux arbres. Ils errent dans les hôpitaux avec au moins vingt victimes de la puissance de feu américaine pour une blessure infligée par le Vietcong. Jusqu’à présent, nous avons peut-être tué un million d’entre eux, surtout des enfants. Ils errent dans les villes et voient des milliers d’enfants sans abri, sans vêtements, courant en bandes dans les rues comme des animaux. Ils voient les enfants dégradés par nos soldats alors qu’ils mendient de la nourriture. Ils voient les enfants vendre leurs sœurs à nos soldats, solliciter pour leurs mères.
Que pensent les paysans quand nous nous allions aux propriétaires terriens et que nous refusons de mettre en œuvre nos nombreuses paroles sur la réforme agraire ? Que pensent-ils quand nous testons nos dernières armes sur eux, tout comme les Allemands testaient de nouveaux médicaments et de nouvelles tortures dans les camps de concentration d’Europe ? Où sont les racines du Vietnam indépendant que nous prétendons construire ? Est-ce parmi ces sans-voix ? Nous avons détruit leurs deux institutions les plus chères : la famille et le village. Nous avons détruit leur terre et leurs cultures. Nous avons coopéré à l’écrasement – à l’écrasement de la seule force politique révolutionnaire non communiste du pays, l’Église bouddhiste unifiée. Nous avons soutenu les ennemis des paysans de Saigon. Nous avons corrompu leurs femmes et leurs enfants et tué leurs hommes. Il ne reste plus grand-chose sur quoi bâtir, sinon l’amertume. Bientôt, les seules fondations physiques solides restantes se trouveront dans nos bases militaires et dans le béton des camps de concentration que nous appelons « hameaux fortifiés ». Les paysans peuvent bien se demander si nous prévoyons de construire notre nouveau Vietnam sur de tels fondements. Pourrions-nous leur reprocher de penser cela ?
Nous devons parler pour eux et poser les questions qu’ils ne peuvent pas poser. Eux aussi sont nos frères.
Peut-être une tâche plus difficile mais non moins nécessaire est de parler pour ceux qui ont été désignés comme nos ennemis. Qu’en est-il du Front national de libération, ce groupe étrangement anonyme que nous appelons « VC » ou « communistes » ? Que doivent-ils penser des États-Unis quand ils réalisent que nous avons permis la répression et la cruauté de Diệm, qui a contribué à les faire naître en tant que groupe de résistance dans le Sud ? Que pensent-ils de notre tolérance de la violence qui les a conduits à prendre les armes ? Comment peuvent-ils croire en notre intégrité quand maintenant nous parlons d’« agression du Nord » comme s’il n’y avait rien de plus essentiel à la guerre ? Comment peuvent-ils nous faire confiance quand maintenant nous les accusons de violence après le règne meurtrier de Diệm et les accusons de violence tandis que nous déversons chaque nouvelle arme de mort sur leur terre ? Nous devons sûrement comprendre leurs sentiments, même si nous ne cautionnons pas leurs actions. Nous devons sûrement voir que les hommes que nous avons soutenus les ont poussés à la violence. Nous devons sûrement voir que nos propres plans informatisés de destruction éclipsent de loin leurs plus grands actes. Comment nous jugent-ils quand nos officiels savent que leur membership est inférieure à vingt-cinq pour cent communiste, et pourtant insistent pour leur donner ce nom générique ? Que doivent-ils penser quand ils savent que nous sommes conscients de leur contrôle de grandes sections du Vietnam, et pourtant nous semblons prêts à permettre des élections nationales dans lesquelles ce gouvernement parallèle politique hautement organisé n’aura pas de place ? Ils demandent comment nous pouvons parler d’élections libres quand la presse de Saigon est censurée et contrôlée par la junte militaire. Et ils ont sûrement raison de se demander quel genre de nouveau gouvernement nous prévoyons d’aider à former sans eux, le seul parti en réel contact avec les paysans. Ils questionnent nos objectifs politiques et ils nient la réalité d’un règlement de paix dont ils seraient exclus. Leurs questions sont effrayantes de pertinence. Notre nation prévoit-elle de construire à nouveau sur un mythe politique, puis de le soutenir par le pouvoir d’une nouvelle violence ?
Voici la véritable signification et la valeur de la compassion et de la non-violence, quand cela nous aide à voir le point de vue de l’ennemi, à entendre ses questions, à connaître son évaluation de nous-mêmes. Car de son point de vue nous pouvons en effet voir les faiblesses fondamentales de notre propre condition, et si nous sommes matures, nous pouvons apprendre, grandir et profiter de la sagesse des frères qu’on appelle l’opposition.
Il en va de même pour Hanoï. Au Nord, où nos bombes pilonnent maintenant la terre et où nos mines mettent en danger les voies navigables, nous rencontrons une méfiance profonde mais compréhensible. Parler pour eux, c’est expliquer ce manque de confiance dans les paroles occidentales, et surtout leur méfiance envers les intentions américaines actuelles. À Hanoï se trouvent les hommes qui ont conduit la nation à l’indépendance contre les Japonais et les Français, les hommes qui ont cherché l’adhésion au Commonwealth français et ont été trahis par la faiblesse de Paris et la volonté des armées coloniales. Ce sont eux qui ont mené une seconde lutte contre la domination française à des coûts énormes, puis ont été persuadés d’abandonner les terres qu’ils contrôlaient entre le treizième et le dix-septième parallèle comme mesure temporaire à Genève. Après 1954, ils nous ont vus conspirer avec Diệm pour empêcher des élections qui auraient sûrement porté Hô Chi Minh au pouvoir sur un Vietnam unifié, et ils ont réalisé qu’ils avaient été trahis à nouveau. Quand nous demandons pourquoi ils ne sautent pas sur les négociations, ces choses doivent être rappelées. Il doit aussi être clair que les dirigeants de Hanoï considéraient la présence de troupes américaines en soutien au régime Diệm comme la première violation militaire de l’accord de Genève concernant les troupes étrangères. Ils nous rappellent qu’ils n’ont commencé à envoyer des troupes en grand nombre, et même des fournitures, dans le Sud que lorsque les forces américaines étaient passées aux dizaines de milliers. Hanoï se souvient comment nos dirigeants ont refusé de nous dire la vérité sur les offres de paix antérieures du Nord-Vietnam, comment le président a prétendu qu’aucune n’existait alors qu’elles avaient clairement été faites. Hô Chi Minh a regardé tandis que l’Amérique parlait de paix et renforçait ses forces, et maintenant il a sûrement entendu les rumeurs internationales croissantes sur les plans américains d’invasion du Nord. Il sait que les bombardements, les tirs d’artillerie et les mines que nous faisons font partie de la stratégie traditionnelle de pré-invasion. Peut-être que seul son sens de l’humour et de l’ironie peut le sauver quand il entend la nation la plus puissante du monde parler d’agression alors qu’elle largue des milliers de bombes sur une pauvre nation faible à plus de huit mille miles de ses côtes.
À ce stade, je devrais préciser que, bien que j’aie essayé ces dernières minutes de donner une voix aux sans-voix au Vietnam et de comprendre les arguments de ceux qu’on appelle « ennemis », je suis aussi profondément préoccupé par nos propres troupes là-bas que par n’importe quoi d’autre. Car il me semble que ce à quoi nous les soumettons au Vietnam n’est pas simplement le processus de brutalisation qui se produit dans n’importe quelle guerre où les armées s’affrontent et cherchent à se détruire. Nous ajoutons du cynisme au processus de mort, car ils doivent savoir après une courte période là-bas qu’aucune des choses pour lesquelles nous prétendons nous battre n’est vraiment impliquée. Avant longtemps, ils doivent savoir que leur gouvernement les a envoyés dans une lutte entre Vietnamiens, et les plus sophistiqués réalisent sûrement que nous sommes du côté des riches et des sécurisés, tandis que nous créons un enfer pour les pauvres.
Cette folie doit cesser. Nous devons arrêter maintenant. Je parle en tant qu’enfant de Dieu et frère des pauvres souffrants du Vietnam. Je parle pour ceux dont la terre est dévastée, dont les maisons sont détruites, dont la culture est subvertie. Je parle pour les pauvres d’Amérique qui paient le double prix d’espoirs brisés chez eux et de mort et de corruption au Vietnam. Je parle en tant que citoyen du monde, pour le monde qui reste consterné devant le chemin que nous avons pris. Je parle en tant que quelqu’un qui aime l’Amérique, aux dirigeants de notre propre nation : la grande initiative dans cette guerre est la nôtre ; l’initiative pour l’arrêter doit être la nôtre.
C’est le message des grands dirigeants bouddhistes du Vietnam. Récemment, l’un d’eux a écrit ces mots, et je cite : « Chaque jour que la guerre dure, la haine augmente dans le cœur des Vietnamiens et dans le cœur de ceux qui ont un instinct humanitaire. Les Américains forcent même leurs amis à devenir leurs ennemis. Il est curieux que les Américains, qui calculent si soigneusement les possibilités de victoire militaire, ne réalisent pas que dans le processus ils subissent une profonde défaite psychologique et politique. L’image de l’Amérique ne sera plus jamais l’image de la révolution, de la liberté et de la démocratie, mais l’image de la violence et du militarisme. »
Si nous continuons, il n’y aura aucun doute dans mon esprit ni dans celui du monde que nous n’avons aucune intention honorable au Vietnam. Si nous n’arrêtons pas immédiatement notre guerre contre le peuple du Vietnam, le monde sera laissé sans autre alternative que de voir cela comme un horrible, maladroit et mortel jeu que nous avons décidé de jouer.
Le monde exige maintenant une maturité de l’Amérique que nous ne pourrons peut-être pas atteindre. Il exige que nous admettions que nous avons eu tort depuis le début de notre aventure au Vietnam, que nous avons été nuisibles à la vie du peuple vietnamien. La situation est telle que nous devons être prêts à tourner brusquement de nos voies actuelles.
Pour expier nos péchés et nos erreurs au Vietnam, nous devrions prendre l’initiative d’arrêter cette guerre tragique. Je voudrais suggérer cinq choses concrètes que notre gouvernement devrait faire [immédiatement] pour commencer le long et difficile processus de nous extraire de ce conflit cauchemardesque :
1. Mettre fin à tous les bombardements au Nord et au Sud Vietnam.
2. Déclarer un cessez-le-feu unilatéral dans l’espoir que cette action créera l’atmosphère pour des négociations.
3. Prendre des mesures immédiates pour empêcher d’autres champs de bataille en Asie du Sud-Est en réduisant notre renforcement militaire en Thaïlande et notre ingérence au Laos.
4. Accepter réalistement le fait que le Front national de libération a un soutien substantiel au Sud-Vietnam et doit par conséquent jouer un rôle dans toute négociation significative et dans tout futur gouvernement vietnamien.
5. Fixer une date à laquelle nous retirerons toutes les troupes étrangères du Vietnam conformément à l’accord de Genève de 1954.
Une partie de notre engagement continu pourrait bien s’exprimer par une offre d’asile à tout Vietnamien qui craint pour sa vie sous un nouveau régime incluant le Front de libération. Ensuite, nous devons faire ce que nous pouvons en termes de réparations pour les dommages que nous avons causés. Nous devons fournir l’aide médicale dont on a tant besoin, la rendant disponible dans ce pays si nécessaire.
Pendant ce temps, nous dans les églises et les synagogues avons une tâche continue tandis que nous pressons notre gouvernement de se désengager d’un engagement honteux. Nous devons continuer à élever nos voix et nos vies si notre nation persiste dans ses voies perverses au Vietnam. Nous devons être prêts à assortir les actions aux paroles en cherchant chaque méthode créative de protestation possible.
En conseillant les jeunes hommes sur le service militaire, nous devons clarifier pour eux le rôle de notre nation au Vietnam et les confronter à l’alternative de l’objection de conscience. Je suis heureux de dire que c’est un chemin maintenant choisi par plus de soixante-dix étudiants à mon alma mater, Morehouse College, et je le recommande à tous ceux qui trouvent le cours américain au Vietnam déshonorant et injuste. De plus, j’encouragerais tous les ministres d’âge de conscription à renoncer à leurs exemptions ministérielles et à demander le statut d’objecteurs de conscience.
Ce sont les temps pour de vrais choix et non de faux. Nous sommes au moment où nos vies doivent être mises en jeu si notre nation veut survivre à sa propre folie. Chaque homme de convictions humaines doit décider de la protestation qui convient le mieux à ses convictions, mais nous devons tous protester.
Maintenant, il y a quelque chose de séduisamment tentant à s’arrêter là et à nous envoyer tous sur ce qui, dans certains cercles, est devenu une croisade populaire contre la guerre au Vietnam. Je dis que nous devons entrer dans cette lutte, mais je souhaite maintenant aller plus loin et dire quelque chose d’encore plus troublant.
La guerre au Vietnam n’est qu’un symptôme d’un mal bien plus profond dans l’esprit américain, et si nous ignorons cette réalité sobering… et si nous ignorons cette réalité sobering, nous nous retrouverons à organiser des comités « clergé et laïcs concernés » pour la prochaine génération. Ils seront concernés par le Guatemala et le Pérou. Ils seront concernés par la Thaïlande et le Cambodge. Ils seront concernés par le Mozambique et l’Afrique du Sud. Nous marcherons pour ces noms et une douzaine d’autres sans fin, à moins qu’il n’y ait un changement significatif et profond dans la vie et la politique américaines.
Et ainsi, de telles pensées nous mènent au-delà du Vietnam, mais pas au-delà de notre vocation en tant que fils du Dieu vivant.
En 1957, un officiel américain sensible à l’étranger a dit qu’il lui semblait que notre nation était du mauvais côté d’une révolution mondiale. Au cours des dix dernières années, nous avons vu émerger un schéma de répression qui a maintenant justifié la présence de conseillers militaires américains au Venezuela. Ce besoin de maintenir la stabilité sociale pour nos investissements explique l’action contre-révolutionnaire des forces américaines au Guatemala. Cela explique pourquoi des hélicoptères américains sont utilisés contre des guérillas au Cambodge et pourquoi des napalm américain et des forces Green Beret ont déjà été actifs contre des rebelles au Pérou.
C’est avec une telle activité à l’esprit que les mots du regretté John F. Kennedy nous reviennent hanter. Il y a cinq ans, il a dit : « Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable. »
De plus en plus, par choix ou par accident, c’est le rôle que notre nation a pris, le rôle de ceux qui rendent la révolution pacifique impossible en refusant d’abandonner les privilèges et les plaisirs qui viennent des immenses profits des investissements outre-mer.
Je suis convaincu que si nous voulons nous placer du bon côté de la révolution mondiale, nous en tant que nation devons subir une révolution radicale des valeurs. Nous devons rapidement commencer… nous devons rapidement commencer le passage d’une société orientée vers les choses à une société orientée vers les personnes. Quand les machines et les ordinateurs, les motifs de profit et les droits de propriété sont considérés plus importants que les personnes, les triplets géants du racisme, de l’extrémisme matérialiste et du militarisme sont incapables d’être vaincus.
Une véritable révolution des valeurs nous amènera bientôt à questionner l’équité et la justice de beaucoup de nos politiques passées et présentes. D’un côté, nous sommes appelés à jouer le Bon Samaritain au bord de la route de la vie, mais ce ne sera qu’un acte initial. Un jour, nous devons en venir à voir que toute la route de Jéricho doit être transformée afin que les hommes et les femmes ne soient pas constamment battus et volés pendant leur voyage sur l’autoroute de la vie.
La vraie compassion va au-delà de jeter une pièce à un mendiant. Elle en vient à voir qu’un édifice qui produit des mendiants a besoin d’être restructuré.
Une véritable révolution des valeurs regardera avec malaise le contraste criant entre pauvreté et richesse. Avec une juste indignation, elle regardera par-delà les mers et verra des capitalistes individuels de l’Occident investir d’énormes sommes d’argent en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, seulement pour en retirer les profits sans se soucier de l’amélioration sociale des pays, et dira : « Ce n’est pas juste. » Elle regardera notre alliance avec la grande propriété terrienne d’Amérique du Sud et dira : « Ce n’est pas juste. »
La guerre au Vietnam n’est qu’un symptôme. La vraie maladie est le matérialisme extrême, le militarisme et le racisme qui infectent l’âme américaine. Nous devons guérir cela par une révolution des valeurs.















.jpg)



.svg.png)