Du bateau négrier à la Tour Eiffel : 200 ans après la dette de la France à l'égard d'Haïti
Le 17 avril 1825, une puissance impériale esclavagiste impose à son ancienne colonie la première politique néocoloniale de l'histoire
Il n'y a pas de document de civilisation qui ne soit en même temps un document de barbarie". Cette citation bien connue figure dans l'ouvrage du philosophe allemand Walter Benjamin intitulé « Sur le concept d'histoire ». Il serait difficile de trouver une synthèse plus appropriée de l'un des anniversaires les plus tristement célèbres de l'histoire de l'humanité : le bicentenaire rond de l'imposition par la France à Haïti de ce que l'on appelle la « dette d'indépendance », tout comme il serait difficile de trouver un « document de civilisation et de barbarie » plus symbolique et controversé.
Il s'agit du monument européen peut-être le plus emblématique : la Tour Eiffel, universellement connue, infrastructure omniprésente sur les cartes postales, les films, les porte-clés, les livres de poésie et les manuels de français, visitée chaque année par 5 à 7 millions de touristes de toute la planète. Mais qu'est-ce que le symbole favori de la bohème et de la Belle Époque a à voir avec l'histoire tragique de l'esclavage, de la plantation, de la traite des Noirs et du colonialisme ?
Tout a commencé lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, dans la colonie la plus fabuleusement riche de la planète - ce que l'on appelait alors Saint-Domingue, à l'ouest de l'île d'Hispaniola, au milieu de la mer des Caraïbes -, une rébellion de propriétaires mulâtres s'est déclenchée, qui ont vu dans la Révolution française une occasion de réclamer l'égalité de leurs droits avec les propriétaires blancs, ainsi que de négocier certaines marges d'autonomie locale et leur propre représentation à la Convention nationale. Jusqu'alors, le sort de centaines de milliers de descendants africains asservis sous le joug brutal de la plantation - principalement mais pas exclusivement sucrière - dans la dynamique infernale de laquelle un esclave vivait en moyenne 7 ans, n'avait pas trouvé de représentants clairs. La soi-disant « perle des Antilles » n'a pas offert tout son éclat.
Mais dans un enchaînement d'événements catastrophiques, tant en France qu'à Saint-Domingue, cette rébellion va libérer les forces dormantes des « damnés de la terre », prenant la forme et le contenu d'une révolution anti-esclavagiste et anti-coloniale (sous le commandement du précurseur Toussaint Louverture), puis les contours d'une révolution anti-plantationniste, nationale, culturelle et indépendantiste (sous la direction du véritable père de la nation haïtienne, le général Jean-Jacques Dessalines, honni - voire carrément réduit au silence - par l'historiographie occidentale, même progressiste). La révolution haïtienne serait même perçue comme une révolution universelle et internationaliste, donnant naissance à la première intelligentsia anticoloniale du continent et promouvant activement la lutte contre l'esclavage, la traite négrière et la déshumanisation dans tout l'hémisphère, du Brésil aux États-Unis. Tout moun se moun, « tous les peuples sont des peuples » en langue nationale haïtienne, sera désormais la devise de l'humanisme anticolonial avancé qui émergea du cœur de ce que l'on appelle l'« Atlantique noir ».
La révolution haïtienne sera même considérée comme une révolution universelle et internationaliste, donnant naissance à la première intellectualité anticoloniale du continent et promouvant activement la lutte contre l'esclavage, la traite négrière et la déshumanisation dans tout l'hémisphère.
Après 13 ans d'une guerre colossale qui a dévasté l'économie et l'écologie de l'île (les plantations, souvenirs traumatisants, ont été en grande partie anéanties), les anciens esclaves ont finalement vaincu les esclavagistes organisés dans l'armée la plus puissante de la planète, l'armée napoléonienne. Bien avant d'être vaincu à Waterloo en 1815, comme les enfants européens et américains l'apprennent encore à l'école, le Petit Caporal a mordu la poussière dans les champs de Vertières, au nord d'Haïti, en novembre 1813, un revers humiliant pour ceux qui considéraient les indigènes haïtiens comme des sous-hommes, et qui allait sonner le glas du rêve impérial français dans l'hémisphère américain.
De fait, sa rancœur était telle que Napoléon a fait supprimer le nom Haïti - un mot indigène taino fièrement sauvé par les révolutionnaires noirs - des annales de l'État français, ce qui contribue peut-être à expliquer l'ignorance généralisée des Français à ce jour concernant le pays et la terrible histoire coloniale qui les a catapultés en tant que puissance économique mondiale. Mais la France ne sera pas la seule puissance à être humiliée : en influençant intelligemment et audacieusement les conflits inter-hégémoniques du début du siècle, les Haïtiens vaincront également les aspirations impériales des Britanniques et des Espagnols. Un seul autre peuple, les Vietnamiens, rééditera plus d'un siècle et demi plus tard l'exploit singulier d'avoir vaincu trois armées coloniales. De même, les Vietnamiens et les Haïtiens n'arracheront au colonisateur la reconnaissance de leur pleine humanité que par l'exercice méthodique - et parfois chaotique - de la violence révolutionnaire.
Ainsi, le 1er janvier 1804, le monde allait voir naître la révolution la plus radicale de l'histoire de l'humanité (la révolution américaine dont on parle tant ne serait qu'une promenade dominicale), une République noire fière et souveraine, la première nation indépendante de l'hémisphère sud, antécédent incontournable des révolutions d'indépendance hispano-américaines de 1809-1825, redevable de la première révolution.
Après 13 ans d'une guerre colossale qui a dévasté l'économie et l'écologie de l'île (les plantations, souvenirs traumatisants, ont été en grande partie anéanties), les anciens esclaves ont finalement vaincu les esclavagistes organisés dans l'armée la plus puissante du monde, l'armée napoléonienne.
Mais, anticipant le destin de toutes les révolutions du XXe siècle, la révolution haïtienne devait être une révolution encerclée, exclue et attaquée. Le patriote américain Thomas Jefferson, éminent esclavagiste, donne le ton de la politique occidentale à l'égard de la jeune république : "Tant que nous empêcherons les nègres de posséder des navires, nous pourrons autoriser leur existence et continuer à entretenir avec eux des échanges commerciaux très lucratifs [...] Haïti peut exister en tant que grand établissement marron, Quilombo ou Palenque. Mais il n'est pas question de les accepter dans le concert des nations". Toute similitude avec la politique des « armées blanches » contre la révolution bolchevique de 1917 ou des Etats-Unis contre le Cuba de Fidel Castro n'est bien sûr pas une simple coïncidence.
Cette approche, qui a entraîné pendant des années l'isolement diplomatique et commercial le plus sévère pour Haïti, a été complétée par la position française. Rapidement, les anciens colons survivants, certains revenus en métropole, d'autres ayant fui avec leurs « biens humains » vers les îles voisines, se réorganisent pour exiger la plus insolite et la plus immorale des revendications : que les anciens esclaves paient aux anciens esclavagistes le prix de leur liberté, pour être « indemnisés » de la perte de leurs terres et de leurs plantations ; et dans le cas de l'État français, de leurs navires et de leurs petrechos de guerre.
L'argument n'ayant pas du tout convaincu les patriotes et les masses haïtiennes qui s'étaient battus sous le slogan éloquent de « la liberté ou la mort », la France a dû appuyer sa « demande » en déployant une escadre de 14 navires de guerre dans la baie de Port-au-Prince, prêts à envahir le pays, à le recoloniser et à rétablir l'odieux esclavage, comme ils l'ont clairement indiqué. C'est ainsi que, sous la contrainte militaire, l'État haïtien a été contraint d'accepter sa « dette » ; la première politique néocoloniale de l'histoire a ainsi été consommée au sens strict du terme.
La somme exorbitante exigée s'élève à 150 millions de francs. À plusieurs reprises, tout au long du 19ème siècle, Haïti a été contraint de demander des prêts successifs à la France et aux États-Unis pour refinancer, à des taux ridicules, une dette impayable qui, entre 1825 et 1883, a étranglé son économie et aspiré une grande partie de la richesse nationale, alors même que le pays bénéficiait du boom international des prix du café (toute ressemblance avec le modus operandi actuel de la Banque mondiale ou du FMI n'est pas non plus une coïncidence).
Certaines estimations montrent que sur 3 dollars produits par le pays, seuls 6 cents restaient dans le pays : le reste s'échappait dans les poches sans fond des agiotistes, principalement le CIC, la banque du « Crédit Industriel et Commercial ». Ainsi, ce sigle anodin est devenu le nom infamant du nouveau colonisateur, et le pays a été enfermé, comme au temps de l'Ancien Régime, dans une autre Bastille : la prison néocoloniale de la dette. « Une banque sans mémoire », disait Nicolas Stoskopf à propos du CIC, une institution de crédit qui existe toujours et qui a effacé Haïti de ses bilans financiers, comme Napoléon avait effacé le nom du pays ; un mémorial planifié qui se répète sans cesse jusqu'à aujourd'hui.
Finalement, une partie de la dette sera absorbée par les banques américaines lorsque le pays envahira Haïti et prendra le contrôle de ses finances dans une occupation militaire qui durera près de deux décennies, entre 1915 et 1934. Le dernier dollar de cette dette transférée n'a été payé qu'en 1947, 122 ans après son imposition !
Pour en revenir à la France, il faut dire que c'est l'argent des paysans et des ouvriers haïtiens qui a permis de construire plusieurs des monuments de la Belle Époque, aujourd'hui si empreints de la nostalgie coloniale d'une ancienne puissance en déclin : parmi eux, la Tour Eiffel, qui a été financée par l'argent que le CIC a prélevé en Haïti. Chaque année, les millions de touristes qui la visitent génèrent des recettes estimées à 112 millions de dollars. Paradoxe grotesque de l'histoire, ce montant représente deux fois ce que l'État haïtien dépense annuellement en soins de santé pour une population de 11 millions d'habitants.
Si nous parlons de chiffres froids, il est nécessaire de se demander combien d'argent le montant de cette dette odieuse représente aujourd'hui. Pour ne citer qu'un exemple, le chiffre estimé de 115 milliards de dollars représente presque six fois le PIB actuel d'Haïti et pourrait soulager la situation économique, humanitaire et sécuritaire critique du pays le plus appauvri de la région et - depuis la militarisation de son territoire par les États-Unis - également l'un des plus violents. Les organismes de prêt internationaux définissent Haïti avec un autre acronyme pervers : comme un « PPTE », un « pays pauvre très endetté » pour un montant d'environ 6 milliards de dollars. Bien au contraire, l'histoire prouve de manière irréfutable qu'Haïti est un créancier légitime de son ancienne puissance coloniale, sans compter ce qui est légitimement et moralement dû en termes de réparations pour les crimes de la traite négrière, de l'esclavage et de la plantation, une revendication qui jouit d'un énorme soutien parmi les peuples des Caraïbes.
Alors que le monde occidental se lamente hypocritement sur le sort malheureux d'Haïti, il ignore que la dette que la France doit payer pourrait financer, pour ne citer que quelques exemples, la construction d'un réseau national d'eau potable pour éradiquer le choléra que les Nations Unies ont introduit en Haïti en 2010 ; ou l'amélioration des infrastructures routières dans un pays où les deux principales villes - Port-au-Prince et Cap-Haïtien - situées à une distance discrète de 200 kilomètres, n'ont pas de route goudronnée pour les relier. Ou encore l'équipement et la formation d'une police nationale malmenée, seule force de sécurité du pays, qui, avec ses quelques milliers d'hommes, doit affronter quotidiennement des groupes paramilitaires armés, entraînés et financés par des trafiquants de drogue et des mercenaires américains. La liste serait interminable.
La France peut refuser cette revendication, mais elle ne peut pas feindre la folie. Le paiement de la « dette de l'indépendance » a été publiquement exigé par le dernier président pleinement démocratique d'Haïti, le prêtre salésien et ancien leader progressiste Jean-Bertrand Aristide, qui a demandé 21 milliards de dollars de réparations à l'État haïtien au début de ce siècle. La réponse à cette demande a été une intervention militaire conjointe de la France, du Canada et des États-Unis qui l'ont chassé du pouvoir pour cette audace et d'autres ; l'occupation a eu lieu, à la grande joie de l'esprit de Napoléon, l'année même où Haïti célébrait le bicentenaire de sa révolution pour l'indépendance.
Rappelons également que c'est la France qui a abrité l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, fils de François Duvalier - le redoutable Papa Doc - qui, ensemble, ont châtié leur pays dans une dictature à vie qui a duré 29 ans ; Un régime soutenu par les Etats-Unis dans le contexte de la guerre froide et pionnier de la doctrine contre-insurrectionnelle développée par les Français en Algérie et au Vietnam, dont il a tiré des « techniques » telles que l'organisation de groupes paramilitaires, les massacres sélectifs, les disparitions de personnes et les centres de détention clandestins. En outre, Papa Doc et Baby Doc ont volé pas moins de 900 millions de dollars au Trésor public haïtien.
Peu de gens se souviennent de cette étape démocratique en France, tout comme peu de gens se souviennent que l'antécédent de la chambre à gaz nazie moderne était les « gazages » imposés par Napoléon pour traiter les esclaves rebelles en Haïti et dans ses autres possessions coloniales dans les Caraïbes. Ce n'est pas par hasard qu'Hitler a décidé de rendre un hommage solennel à la tombe de Napoléon en juin 1940, pendant l'occupation nazie, dans un acte public et quelque peu obscène de solidarité intercoloniale.
Seuls deux présidents français se sont rendus en Haïti dans son histoire, et tous deux l'ont fait deux siècles après cette révolution extraordinaire. Ainsi, lors d'une tournée dans les Caraïbes francophones et avant d'arriver dans le pays, le « socialiste » François Hollande déclarait en 2010 : « Quand j'arriverai en Haïti, je paierai la dette que nous avons ». Malheureusement, il se référait à une dette strictement morale ; une dette qui ne construit pas de routes, ne finance pas d'écoles, ne guérit pas le choléra, ne garantit pas de crédit aux agriculteurs, ni de droits pour les femmes et les enfants. Mais Haïti n'a pas besoin de châtiments moraux ou d'excuses symboliques : elle a besoin et exige ce qui lui est dû, les millions de dollars qui pourraient aujourd'hui, 200 ans après cette dette infâme qui a conditionné toute son histoire moderne, financer sa reconstruction.
























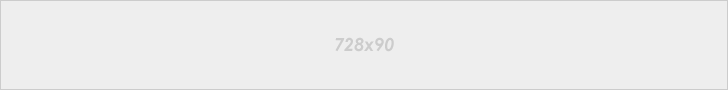










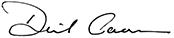
Aucun commentaire: